Bestial bestiaire littéraire
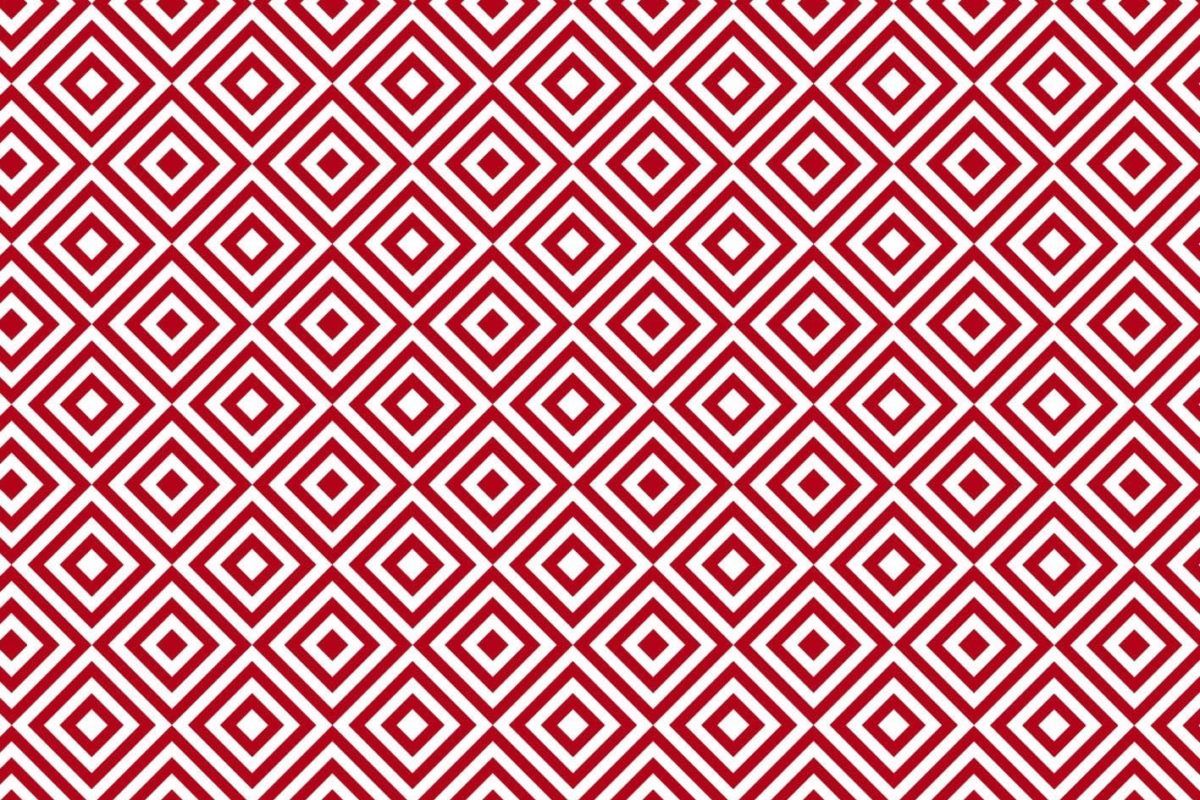
Dénicheuse de trésors enfouis dans le foisonnement de la littérature nord-américaine d’hier et d’aujourd’hui, la petite maison d’édition indépendante Monsieur Toussaint Louverture, basée à Toulouse, s’affiche comme un acteur incontournable dans la sphère de la publication pointue : il s’agit de fait d’une véritable tête chercheuse de chefs-d’œuvre à la marge. Parmi son catalogue bien fourni en perles, une collection intitulée Les Grands Animaux – quatre ouvrages à ce jour – tape immédiatement dans l’œil de par ses jaquettes soignées, précieusement marquées de motifs géométriques scintillants et, sur le dos et la couverture, de ces énigmatiques animaux coiffés de cornes, qu’ils soient cervidés, hippopotame ou béluga. La ramure orientée dans le sens de la lecture, ces créatures invitent le lecteur à s’immerger corps et âme au sein des vertigineux univers dépeints dans ces quatre grandioses mais jusqu’alors relativement méconnus romans américains du siècle dernier, remédiant à l’injustice qui les confinait dans l’ombre. C’est ainsi que Monsieur Toussaint Louverture révèle jusqu’à l’éblouissement toute la lumière que ces écrits portent en eux, et de laquelle Go Out ! vous propose ici quelques fugaces reflets.

Robert Penn Warren (1905-1989), immense poète, romancier et intellectuel, est à ce jour le seul écrivain à avoir été honoré de trois prix Pulitzer, dont l’un lui a été décerné pour son œuvre Tous les hommes du roi, publiée la première fois en 1946 et pierre angulaire de sa vie et de sa carrière. Dans ce roman construit sur fond de manigances politiques se dégagent les relents poisseux et lourds de culpabilité du Sud des Etats-Unis, les fronts dégoulinants de sueur des notables de province ventripotents y disputant la primauté avec la scélératesse déployée dans la course aux pouvoirs maigres et étendus. Au gré d’allers-retours dans le temps agencés avec finesse, on y suit l’étonnante trajectoire de Willie Stark, alias le Boss, bouseux têtu devenu gouverneur intransigeant, sauf avec le respect de la loi. Le tout sous le regard désabusé du narrateur, Jack Burden, observateur à la fois proche et détaché du Boss, collaborateur et membre de son entourage, ou plutôt de sa cour, qui se retrouve aux premières loges du drame qui se joue au fil des pages.
L’intrigue politique sert de fil rouge mais se présente en filigrane, prétexte à dévoiler les rouages sombres de l’âme humaine. Tous les hommes du roi est avant tout un roman qui transporte dans les strates du temps et le poids de son inexorable sentence, et celui de la filiation qui s’insinue ; un ouvrage où la sublime plume tour à tour lyrique puis acérée de Robert Penn Warren se mue en poignard qui se plante dans les tripes du lecteur, les expédiant en des cieux métaphysiques, distillant au passage son encre dans l’esprit de façon marquante. Une œuvre construite comme une toile d’araignée, belle, ciselée, inoubliable de par sa poétique délicatesse tout comme par sa force implacable.
Tous les hommes du roi
De Robert Penn Warren
640 pages

Fi de lyrisme, Personne ne gagne est le récit brut d’une vie affranchie ; publié en 1926, cet ouvrage autobiographique de Jack Black (né Thomas Callaghan en 1871 et décédé en 1932 dans des conditions mystérieuses), transporte le lecteur dans l’univers en pleine mutation des Etats-Unis à l’orée du XXème siècle, mais reste pourtant terriblement actuel par ce refus des conventions qui l’habite de part en part.
Très tôt orphelin de mère, flanqué d’un père qui a d’autres chats à fouetter, le jeune Jack passe vite de la fin de l’internat chez les bonnes sœurs à une vie sur la route et sur les rails, au jour le jour, d’une aventure à l’autre. L’homme étant un animal social, il s’acoquine rapidement de la généralement bienveillante compagnie des hobos rencontrés en chemin et ne perd pas une miette de leurs conseils avisés sur l’art de survivre totalement libre dans l’Ouest américain de la fin du XIXème. De petits larcins en maîtrise de l’art du perçage des coffres-forts, de séjours en prison ponctuels à la cavale quasi permanente, le gamin à la tête pleine de rêves simples se mue au fil des pages en malfrat rodé aux techniques du crime et largement accro aux fumeries d’opium et aux salles de jeux… jusqu’à ce que l’histoire prenne un tour encore différent.
Pas manichéen pour deux sous, Jack Black livre un récit d’une honnêteté déconcertante, une analyse fine de ce qui pousse des individus vers la marge et de la violence inhérente à un système judiciaire qui torture et condamne à mort. Son regard aguerri n’est complaisant ni à l’égard de ceux qui se prélassent dans l’aveuglement bien-pensant, ni sur le prix à payer pour s’en extraire et le combat quotidien pour préserver sa liberté. « Personne ne gagne », en effet, si ce n’est l’intemporalité de cette affirmation.
Personne ne gagne
De Jack Black
480 pages

Plus de vingt personnes et huit ans de travail : voilà le niveau d’exigence qu’ont requis la traduction et l’édition de ce monument de littérature par Monsieur Toussaint Louverture – un acharnement qui mérite la reconnaissance éternelle de nombreux lecteurs francophones. Car Et quelquefois j’ai comme une grande idée de Ken Kesey (1935-2001), plus connu pour avoir écrit Vol au-dessus d’un nid de coucou, est la définition même du chef-d’œuvre : une claque magistrale et inoubliable.
A l’aube des années soixante dans un petit bled côtier de l’Oregon où tout et tous subsistent grâce au commerce du bois, une communauté de bûcherons en grève rencontre la résistance d’un clan local, les irréductibles Stamper, ces hommes aux yeux verts qui persistent à exploiter la forêt et vendre leur bois à une importante compagnie. Rarement la description de la trame d’un roman n’aura dit si peu à son sujet : si Et quelquefois j’ai comme une grande idée traite des luttes syndicales, celles-ci ne représentent qu’une part infime des combats qui émaillent l’ouvrage, par ailleurs servi par une remarquable écriture, jamais pesante. Combat permanent mené contre la nature – protagoniste principale, somptueusement dépeinte – impitoyable, fourbe, débordante à l’image de la rivière Wakonda Auga, ses flux et reflux, et de ces arbres vaillants qu’il faut abattre ; combat contre la fatalité de la filiation et des rivalités fraternelles, contre l’âcre poison distillé par la rancœur, contre les non-dits qui déforment les vies en silence, jour après jour… Grâce à une narration très habile servie par des astuces typographiques, on navigue entre la description des scènes, les dialogues et les voix intérieures des personnages : le résultat engloutit le lecteur et en marque l’esprit aussi intensément que du vécu hors norme.
C’est résolument l’un de ces livres, ceux dont on osait à peine rêver l’existence, dont on tourne la dernière page dans la douleur, sans tout à fait réaliser alors qu’il nous aura chamboulé pour toujours ; une lecture indispensable.
Et quelquefois j’ai comme une grande idée
De Ken Kesey
896 pages
www.monsieurtoussaintlouverture.net

Roman pour partie autobiographique (mais jusqu’où ?), Le dernier stade de la soif pourrait être le manifeste de tous les génies incompris. Génial, Frederick Exley (1929-1992) l’était assurément, et donc forcément une âme à la marge.
Alcoolique notoire, lettreux bourré de références, artiste de l’auto-sabotage affectif et professionnel, fan absolu de l’équipe de football américain new-yorkaise des Giants et au bénéfice de plusieurs passages en institutions psychiatriques, Exley le bigarré croque avec autodérision, lucidité et une plume stupéfiante une existence hors norme et parsemée d’échecs. Au fil de ceux-ci, racontés dans une chronologie saccadée par les souvenirs qui remontent à la surface et l’analyse qui en découle, il parcourt les Etats-Unis d’un bout à l’autre au cours des années 50 et 60, ponctuant son périple de séjours à l’asile et de rencontres plus incroyables les unes que les autres ; tellement invraisemblables, d’ailleurs, que ces personnages parfaitement hallucinants doivent obligatoirement tirer leur sève du vécu de l’auteur, ce qui en dit long sur sa densité, croyez-le bien. Bien entendu, Frederick Exley se frotte à la « normalité », s’y insinue et prétend s’y complaire par moments, mais il se trouve toujours comme rattrapé par son authentique lui-même, vaincu par sa propre moelle et une inexorable fatalité.
L’écrivain maudit ne se laisse cependant jamais happer par l’auto-apitoiement, et livre une œuvre pleine de relief, aussi drôle que touchante, un vrai délice doux-amer. Grâce à son panache et son acuité sur lui-même et le monde qui l’entoure, Frederick Exley se dessine comme un héros : il incarne l’antithèse du rêve américain, et Le dernier stade de la soif se révèle la sublimation qui émane des fissures putrescentes de l’hypocrite masque qui habille ce sournois mirage.
Le dernier stade de la soif
De Frederick Exley
512 pages
